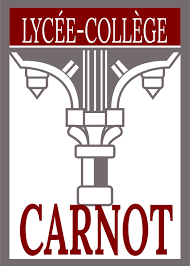Programme de français-philosophie
Thème rentrée 2025-2026 : Expériences de la nature
- Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. Les étudiants de 2e année ont déjà reçu les consignes pour le choix de l’édition. Pour les étudiants de 1re année : si vous êtes en filière PCSI ou MP2I, l’édition recommandée est l’édition Le Livre de Poche. Si vous êtes en filière MPSI ou BCPST, c’est l’édition GF qui est souhaitée.
- La Connaissance de la vie de Georges Canguilhem (« Introduction : La pensée et le vivant », « I. Méthode », « III. Philosophie – chapitres II, III, IV et V »), édition Vrin
- Le Mur invisible de Marlen Haushofer, édition Babel
Vous devez vous procurer les trois ouvrages dans les éditions indiquées et les lire intégralement avant la rentrée. Lisez d’emblée crayon en main pour souligner ce qui est important. Faites ensuite un tri puis reportez quelques citations et éléments d’analyse (idées essentielles, problèmes abordés, scènes frappantes) en rapport avec le thème du concours : expériences de la nature. Vous pouvez aussi, d’ores et déjà, noter les convergences et divergences entre les œuvres car il s’agira de les comparer dans la dissertation proposée au concours. Pensez à indiquer les pages en référence pour un repérage ultérieur plus rapide.
Préférez les modes d’achat responsables, soit en librairie, soit sur une plateforme de libraires indépendants : www.leslibraires.fr
Vous trouverez ci-dessous quelques pistes de réflexion pour une lecture croisée des œuvres.
Premier axe : l’homme et la nature
« On jouit non des lois de la nature, mais de la nature. » (Canguilhem)
Noter l’ambiguïté de la notion d’expérience, dont le nom est au pluriel : on peut donc penser tout aussi bien à l’expérimentation scientifique, dont le but est la connaissance des « lois de la nature », qu’à l’expérience personnelle, vécue (comme jouissance, mais aussi sans doute comme épreuve).
a) Connaissance de la nature et expérimentation
« Cette entreprise pleine de risques et de périls qu’est l’expérimentation en biologie » (Canguilhem)
→ Quelle méthode pour une étude du vivant ? Confronter Aronnax / Canguilhem
→ Une expérience construite : quels artefacts ? Le laboratoire / le sous-marin / le mur invisible
→ « Le caractère apparemment alogique, absurde, des procédés de la vie » (Canguilhem) : comment connaître ce qui échappe à la logique humaine ?
→ Des expériences périlleuses
b) L’expérience vécue comme épreuve
→ Expérience de survie
→ L’enfermement : condition d’une expérience authentique de la nature ? N’est-ce pas paradoxal ?
→ Une expérience révélatrice de la nature humaine
c) Jouissance de la nature
→ (Re)découvrir la beauté de la nature (paysages alpins / sous-marins : réfléchir au contraste et aux points communs)
→ Quelles sont les conditions d’une jouissance de la nature ? La solitude ? Une parenthèse dans les activités humaines ?
Deuxième axe : le vivant et son milieu
« Vivre c’est rayonner, c’est organiser le milieu à partir d’un centre de référence qui ne peut lui-même être référé sans perdre sa signification originale. » Canguilhem
a) Nécessité d’un milieu pour le vivant
→ Qu’est-ce qu’un milieu ? Réfléchir à la différence entre lieu et milieu
→ Peut-on vivre dans un autre milieu que son milieu d’origine ?
→ Les capacités d’adaptation du vivant.
b) Milieu humain, milieu animal
« Les hérissons, en tant que tels, ne traversent pas les routes. » Canguilhem
→ La route fait-elle partie du milieu qu’elle traverse ? Chercher les occurrences de l’idée de route dans les trois œuvres
→ Quelles différences entre milieu humain et milieu animal ?
c) Les monstres
→ Dimension biologique de la monstruosité
→ Le rôle du milieu et les questions d’échelle dans la perception de la monstruosité (couleur blanche, yeux « de la taille d’une soucoupe », taille gigantesque… repérer les exemples appropriés)
→ L’humain devenu monstre
Troisième axe : l’homme et l’animal
« Tantôt l’homme s’émerveille du vivant et tantôt, se scandalisant d’être un vivant, forge à son propre usage l’idée d’un règne séparé. » Canguilhem
a) Examen et contestation de la différence homme / animal
« Sans doute l’animal ne sait-il pas résoudre tous les problèmes que nous lui posons, mais c’est parce que ce sont les nôtres et non les siens. » Canguilhem
→ Opposition humanité / animalité ; la crainte, pour l’homme de (re)devenir un animal
→ Regard humain, regard animal : la rencontre avec l’animal comme possibilité d’un décentrement (chercher les occurrences des expériences de pensée par lesquelles on voit le monde à travers les yeux d’un animal)
→ La question de l’individualité : est-elle vraiment spécifique à l’homme ? Comment et pourquoi l’homme dénie-t-il l’individualité à l’animal ? Quels sont les facteurs d’une individualisation de celui-ci pour un regard humain ?
b) Le lien homme / animal
→ Ambiguïté de la relation : animal aliment, instrument, compagnon, ennemi…
c) Enjeux éthiques
→ La vivisection (« ce qui ne pourrait se faire sur l’homme sans crime ») : quelles limites à ce qui est acceptable ? / La chasse : passion, ou tâche accomplie avec répugnance ?
→ Cruauté animale et cruauté humaine
RÉSEAUX SOCIAUX:
CONTACTS:
- téléphone: 03.80.68.63.00 (accueil)
- mail: 0210015c@ac-dijon.fr
ACCÈS NUMÉRIQUE: